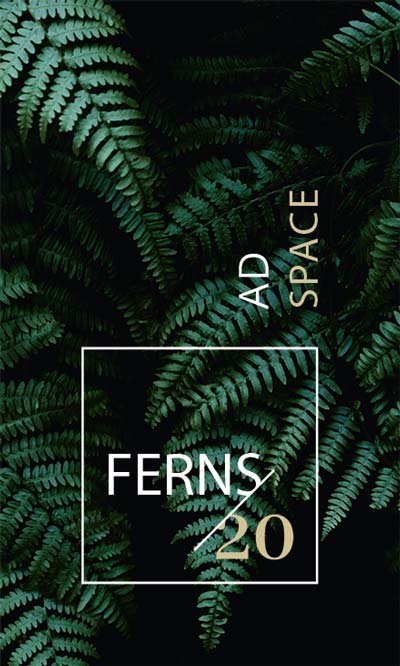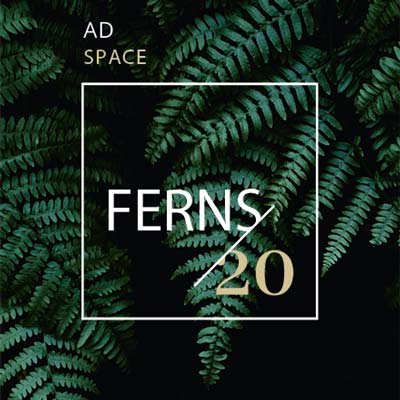Cinq ans après que la COVID-19 a été déclarée urgence sanitaire mondiale, le monde dresse un bilan des leçons tirées d’un combat mené à la fois sur le front scientifique et dans l’univers de la communication de masse.
Un débat passionné a émergé autour de la nécessité et de la faisabilité d’interdire les marchés de viande de brousse, perçus comme des sources potentielles de maladies zoonotiques. Des pays comme le Gabon ont ainsi interdit la vente de pangolins et de chauves-souris.
Dans le bassin du Congo, on estime que 2,5 millions de tonnes d’animaux sauvages sont consommées chaque année. Si les populations rurales et dépendantes des forêts s’appuient sur la viande de brousse pour se nourrir, se soigner et générer des revenus, ce sont les citadins qui, en la considérant comme un mets de choix, en ont stimulé la demande.
Or, la destruction des forêts tropicales et la consommation de viande de brousse sont connues pour accroître le risque de transmission de virus animaux à l’humain, favorisant la propagation de maladies comme le VIH, l’Ebola, le SRAS et, potentiellement, la COVID-19, comme l’ont souligné de nombreux médias à travers le monde.
Dès lors, dans quelle mesure les récits médiatiques ont-ils influencé la perception de la viande de brousse dans le bassin du Congo, la fréquence de sa consommation et le soutien à une éventuelle interdiction ? Et comment ces enseignements peuvent-ils éclairer les futures stratégies de communication et les politiques publiques visant à protéger la faune sauvage et la santé publique ?
Pour répondre à ces questions, des chercheurs du Centre de recherche forestière internationale et du Centre International de Recherche en Agroforesterie (CIFOR-ICRAF), de l’Université d’Oxford et d’autres partenaires ont analysé plus de 260 articles de presse portant sur la consommation de viande de brousse au Cameroun, en République Démocratique du Congo (RDC) et au Gabon, publiés entre 2019 et 2020. Ils ont également mené des enquêtes téléphoniques au Cameroun et en RDC, laquelle abrite environ 60 % de la forêt du bassin du Congo.
Récits médiatiques versus réalités sociales
Si la pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse de la couverture médiatique établissant un lien entre viande de brousse et maladie, son impact sur les comportements des personnes interrogées est resté limité. Les journalistes ne figuraient pas parmi les sources d’information les plus fiables et n’apportaient que rarement des preuves concrètes à l’appui de leurs affirmations sur l’origine du virus ou les effets de la viande de brousse.
« Les articles de presse avaient tendance à insister sur les risques de transmission du virus de l’animal à l’homme via la viande de brousse », a déclaré Yuhan Li, chercheure au CIFOR-ICRAF et auteure principale de l’étude. « Pourtant, nos résultats montrent que les perceptions étaient davantage influencées par l’expérience personnelle, et que les choix alimentaires dépendaient surtout du prix et de la disponibilité des viandes, qu’elles soient sauvages ou domestiques. »
Par ailleurs, moins de la moitié des répondants au Cameroun et en RDC soutenaient l’interdiction du commerce de la viande de brousse, et plus du tiers considérait que la viande rouge domestique présentait davantage de risques sanitaires — révélant ainsi un décalage notable entre le discours médiatique et la réalité vécue.
Les raisons invoquées pour s’opposer à une interdiction incluaient l’importance nutritionnelle et économique de la viande de brousse, son goût, et le scepticisme quant à la faisabilité d’une interdiction à grande échelle.

À Yangambi, en République Démocratique du Congo, des campagnes de sensibilisation sur la viande de brousse sont diffusées à la radio. Photo : Axel Fassio / CIFOR-ICRAF
La pandémie a tout de même modifié les habitudes alimentaires — mais dans les deux sens. Près de 47 % des répondants camerounais et 32 % des répondants en RDC ont déclaré avoir réduit leur consommation de viande de brousse en 2021, souvent à cause de son association avec des maladies.
Dans le même temps, un tiers des personnes interrogées en RDC ont rapporté en avoir consommé davantage cette année-là, principalement en raison de la hausse des prix et du manque d’alternatives de viande. Il est à noter que 45 % des répondants en RDC vivaient en zone rurale, contre seulement 7 % au Cameroun.
« Cela pourrait expliquer les résultats observés, car le ralentissement du commerce durant les premières phases de la pandémie a renforcé la dépendance des communautés rurales à la viande de brousse disponible dans les forêts environnantes », explique Li.
Dan Challender, co-auteur de l’étude à l’Université d’Oxford, a rappelé que de nombreuses voix s’étaient élevées en faveur d’interdictions du commerce de la faune sauvage au plus fort de la pandémie. « Pourtant, nos résultats montrent la complexité de la relation entre les populations d’Afrique centrale et la viande de brousse », affirme-t-il. « Une politique efficace ne peut donc pas se résumer à des interdictions simples. »
Enseignements et perspectives
L’étude conclut que le risque perçu de maladie n’est qu’un facteur parmi d’autres dans la consommation de viande de brousse. Elle révèle aussi un décalage manifeste entre les récits médiatiques et la réalité sociale dans le bassin du Congo.
« Les autorités comme les médias ont la responsabilité de fournir des informations opportunes, basées sur des preuves », souligne Li, insistant sur l’importance de communiquer clairement les incertitudes scientifiques. « Par exemple, il convient de préciser lorsqu’il s’agit d’une hypothèse ou d’un résultat préliminaire, et non d’un fait avéré. »
Li appelle également à approfondir la recherche sur l’influence des réseaux sociaux sur la perception de la viande de brousse, et sur l’évolution des choix alimentaires cinq ans après le début de la pandémie.
Compte tenu du manque d’alternatives signalé, une autre piste essentielle consisterait à évaluer l’impact des initiatives visant à offrir aux communautés des moyens de subsistance durables et d’autres sources de protéines.
Nous vous autorisons à partager les contenus de Forests News/Nouvelles des forêts, qui font l’objet d’une licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Vous êtes donc libres de rediffuser nos contenus dans un but non commercial. Tout ce que nous vous demandons est d’indiquer vos sources (Crédit : Forests News ou Nouvelles des forêts) en donnant le lien vers l’article original concerné, de signaler si le texte a été modifié et de diffuser vos contributions avec la même licence Creative Commons. Il vous appartient toutefois d’avertir Forests News/Nouvelles des forêts si vous republiez, réimprimez ou réutilisez nos contenus en contactant forestsnews@cifor-icraf.org.